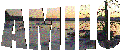 |
Le site pour découvrir et aimer la Lozère |
|
carte
- géographie
- Aubrac
- Margeride
- Causses
- Cévennes
- histoire
- hommes
- faune
- flore
- gastronomie
photos - cinéma - livres - peinture - hébergement - activités - Bête du Gévaudan e-card - fonds d'écran - liens - plan du site - CNIL - Livre d'Or - la lettre - contact |
| >>accueil>>géographie>>géologie |
Un peu de géologie
A l'origine de la création des départements, la Lozère
a failli s'appeler "Lozère des sources" tant il est vrai qu'elle est
un véritable réservoir pour les bassins du Rhône, de
la Garonne et de la Loire. Mais elle aurait aussi bien pu s'appeler "Lozère
des pierres".
En effet, les pierres façonnent ce pays et lui donne son caractère
et peut-être aussi celui de ses habitants. A chaque pays correspond
une pierre. Ainsi l'Aubrac est le pays du basalte, la Margeride celui du
granite, les Cévennes celui du shiste et les Causses celui du calcaire.
Intéressons nous à ces pierres...
Mégalithes
Qu'est-ce qu'un mégalithe ? Si on croit le dictionnaire : n.
m. Monument formé de gros blocs de pierre brute (dolmen, menhir, etc.).
Certaines civilisations du néolithique et de l’âge du bronze
ont élevé des monuments funéraires formés de
très gros blocs, dont certains ont été apportés
de fort loin. L’extraction, le transport sur patins de bois (glissant sur
des rondins) exigeaient des techniques très évoluées.
Les menhirs (pierre levée) sont en groupe ou isolés; le plus
grand, aujourd’hui renversé, nommé Mané-er-Hroëk
(pierre des fées), à Locmariaquer, en Morbihan, mesure 20,50
m et pèse 347,5 tonnes. Les alignements de Carnac (Morbihan) constituent
le plus grand ensemble mégalithique du monde (plus de quatre mille
menhirs, répartis en trois sections). Il faut aller en Inde et au
Tibet pour trouver des monuments analogues. Les cromlechs sont composés
de blocs dressés en cercle. Le plus grandiose est celui de Stonehenge,
en Angleterre. Il s’agit vraisemblablement d’un sanctuaire du culte solaire.
Les tombes mégalithiques sont réparties en deux grandes catégories:
les grottes sépulcrales, naturelles ou artificielles (hypogées),
et les chambres funéraires construites, ou dolmens, composées
d’une grande dalle qui repose sur des piliers. La chambre peut être
rectangulaire, polygonale, circulaire, à couloir, à galerie.
Parfois une antichambre est isolée par une dalle-hublot percée
d’un grand trou rond («la fenêtre de l’âme»). Certains
dolmens sont recouverts d’un tumulus en pierres sèches nommé
cairn. Souvent, un même cairn contient plusieurs dolmens à couloirs
parallèles.
En France, et on le sait peu, le deuxième site en terme de mégalithes,
est la Lozère, et notamment l'alignement de menhirs des Bondons.

|

|

|
|
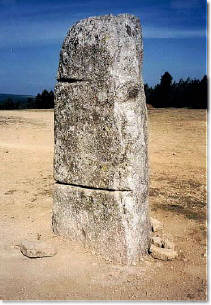
|

|
| Ces photos ont été gentiment mises à notre disposition par Bruno Marc le webmestre du portail du mégalithisme du sud de la France. Pour en savoir plus sur les mégalithes lozériens, visitez sa page Lozère et plus particulièrement sa page sur les Bondons ou son dernier livre : dolmens et menhirs en Cévennes | |
Grottes et avens
Les grottes formées naturellement se creusent de
différentes façons, principalement dues à l'action chimique
de l'eau et de ses composés. De telles cavités sont fréquentes
surtout dans les formations calcaires, particulièrement dans les régions
qui subissent des précipitations importantes. Dans ces régions,
l'eau de surface contient du dioxyde de carbone et des solutions aqueuses
d'acides provenant des constituants organiques du sol. En attaquant le calcaire
soluble, cette eau acide dissout et charrie le calcaire en solution. À
long terme, cela favorise la formation de cavités souterraines. La
profondeur de telles cavités dépend de la profondeur du niveau
des eaux. Si après plusieurs années inhabituellement humides,
le niveau des eaux monte, les anciennes cavités des grottes sont inondées
et de nouvelles grottes commencent à se former plus haut. De même,
pendant une longue période de sécheresse, des cavités
commenceront à se former plus bas, proches du niveau descendant des
eaux. Sur des milliers d'années, de telles fluctuations créent
des réseaux de grottes à plusieurs niveaux, où un cours
d'eau souterrain coule dans les galeries les plus basses.
En Lozère, les grands Causses sont donc propices à la formation
des grottes où on les appelle plus communément des "avens".
Certains sont particulièrement célèbres, l'aven Armand
et la grotte de Dargilan où l'abîme de Bramabiau.
| L'abîme de Bramabiau |
Le gouffre du Mazel |
Au pied du Mont Aigoual, une rivière
souterraine jaillit soudain. Le bruit, amplifié par la résonnance
de la montagne fait penser au bramle d'un boeuf (BRAMABIAU). Ici encore on
trouve le travail du spéléologue E. MARTEL. 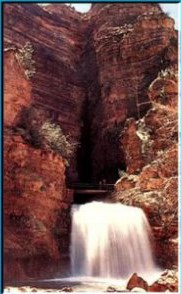
|
Situé sur la commune de Chasseradès, près du hameau du Mas, le gouffre de la Fontaine du
Pré de Mazel est un ensemble de galeries karstiques développées dans les petits causses jurassiques de Daufage - L'Estampe
- Le Mas, prolongements vers l'Est du Causse de Montbel, "blottis" sur le flanc Nord de la Montagne du Goulet, le long de
la faille du même nom. 
Le gouffre a été découvert en 1950 et exploré à partir de 1951. Il présente plus de 5 km de galeries développées à l'horizontale,
dont certaines sont parcourues par une rivière souterraine. On peut y observer de nombreuses concrétions ainsi, que par endroits,
des cimetières de chauves-souris. Découvrez le gouffre du Mazel en photos S'inscrire pour la visite sur le site de Geolozere |
| L'aven Armand |
La grotte de Dargilan |
Situé sur le bord du Causse
Méjean, près de Hures la Parade et à proximité
de la ferme Caussenarde
de Hyélzas, l'aven Armand est accessible au public avec un funiculaire.
Sa taille permettrait d'y loger Notre Dame de Paris. Comme nombre de grottes,
il s'orne de concrétions calcaires qui forment une véritable
forêt. 
L'aven fut exploré la première fois le 19 septembre 1897 par Louis ARMAND accompagné du spéléologue E. MARTEL. |
La grotte rose. Située sur
le Causse Noir, à l'aplomb de Meyrueis, elle fut découverte
en 1880 par M. SAHUQUET un jeune berger, puis, elle fut également
explorée par le spéléologue E. MARTEL. 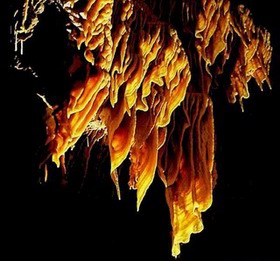
Dargilan est aujourd'hui l'une des grottes les mieux
aménagées pour permettre une visite de qualité.
|
Météorite
Météorite, fragment d'un corps céleste qui a atteint
la surface de la Terre ou d'un autre astre sans être complètement
désintégré. Les météorites découvertes
sur Terre sont classées en familles selon leur composition : les météorites
ferreuses sont principalement constituées de fer, d'un faible pourcentage
de nickel et de traces d'autres métaux tels que le cobalt!; les météorites
pierreuses sont formées de silicates, et les ferro-pierreuses contiennent
des proportions variables de fer et de roches. On considère actuellement
que la plupart des météorites sont des fragments d'astéroïdes
ou de comètes. Cependant, de récentes études géochimiques
ont montré que certaines roches de l'Antarctique proviennent de la
Lune et de Mars, d'où elles ont été éjectées,
présume-t-on, par l'impact explosif d'astéroïdes. Les
astéroïdes sont eux-mêmes des fragments de planétoïdes.
Les météorites présentent en général une
surface alvéolée, et une croûte fuselée et charbonneuse.
Les météorites les plus grandes frappent la Terre dans un choc
terrible, engendrant d'énormes cratères.
La plus grande météorite connue, a un poids estimé à
environ 55 tonnes.
| La Lozère a sa météorite. Le 3 juin 1842, une météorite de deux kilos est tombée sur le Causse à Aumières. | 
|
| Pour en savoir plus sur les météorites. | |
| haut de page | accueil | livre d'or | Association des amis de la Lozère |